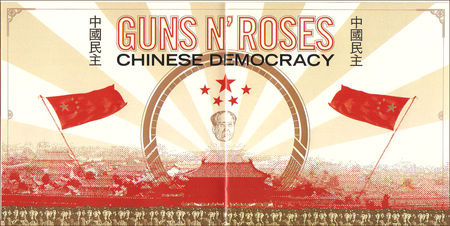J’ai détesté ce voyage. Pas un voyage d’ailleurs, un trajet, car les voyages sont sensés, il me semble, nous dépayser, nous transporter dans un ailleurs qui nous émerveille ou, au pire, nous change tout de même de nos habitudes. Mais ce trajet, moite, étouffant, interminable m’avait tournée et retourné dans tous les sens et m’avais épuisé. J’ai toujours
trouvé par ailleurs que l’immobilité est bien plus exténuante que son contraire, et lorsqu’on la conjuge par dessus le marché avec la présence de phénomènes de foire tels que ceux qui ont croisé ma route, l’indisposition atteint au supplice.
Que le quai de l’arrêt de la gare fut bondé passe encore, j’ai par le passé eu mon lot d’entassements dans des rames aux heures de pointes, et bien que cela ne m’enchante pas de me lancer dans un revival nostalgique, je ne ferait tout de même pas ma mauviette en me plaignant pour si peu. Je profitais des premières «entre-stations», comme je les appelle, pour observer mes compagnons de convoiturage moderne. Une petite femme, plutôt laide, rabougrie, d’un âge indécemment peu élevé compte tenu de son physique, qui, adossée grossièrement aux coussins muraux telle un bovin malade ou prenant le soleil, jettait des oeillades désespérées autour d’elle à travers ses lunettes ovales. Je préférais la fuir du regard, horrifié à l’idée que si elle prenait conscience de mon observation, elle risquait, comme une créature de cauchemard, de me chercher des yeux ou de tenter d’attirer
mon attention de manière ridicule.
Mes yeux se posèrent ensuite sur un homme fort et trapu, vraisemblablement magrhébin,
dont la principale caractéristique était une pilosité hors du commun. Ses bras était recouverts d’une toison qui devait pousser sur l’ensemble de son corps, et qu’on pouvait voir darder, par mèches irrégulières, par le col déboutonné de son polo. Ce qui me poussa à examiner, feignant un air distrait, son style vestimentaire. Il ne faut pas douter que si les goûts en la matière se sont appauvris de génération en génération, la déchéance de la mode atteint des piques de manière cyclique tous les étés, lorsque les jeunes s’affublent des plus hilarants costumes sortis tous droits d’ateliers de stylistes qu’on imagine sans peine lutter pour démêler du regard les rails de coke et les fils de couture blancs, et que les plus âgés ressortent les sempiternels artefacts du mauvais goût, incarnés en la circonstance
par ce short ignoble doublé du polo en coton rouge et blanc de l’homme en question.
Un médaillon en or échappé du col vint parfaire le tableau, me décidant à changer de sujet d’observation.
Nous étions presque à la moitié du trajet, lorsqu’arrivés à la place de l’étoile, la rame s’épura d’une trentaine de personnes, n’en accueillant en retour qu’une petite dizaine
ridicule. Mais cet espace vital, qui me paraissait nouvellement gagné, me fût repris dans le temps exact qu’il faut à un nez pour capter les effluves particulièrement indisposant
transitant à proximité.
Balançant la tête vers la gauche, en prenant évidemment soin de tourner en dernière
instance mes yeux vers le plan du réseau situé au plafond, j’identifiait le problème. Un jeune homme, quelconque, les cheveux blonds rasés si près que peut-être tout compte fait étaient-t-ils bruns, en tenue de sport avec un pull à capuche, et sur l’épaule un sac de sport. Quelle idée de porter un pull en été ! Pourquoi faut-il que les seules personnes qui ne se lavent pas soient en plus celles qui se mettent le plus en situation de transpiration ? Une telle odeur dans un lieu publique peut être caractérisée sans exagérer comme acte incivique,
et je m’étonnait parfois dans ces cas-là qu’une amende n’ait pas été prévue à cet effet. Je me surpris à prier distraitement le ciel de le faire sortir au prochain arrêt, et le fait d’avoir été exaucé m’a fait ressentir, je m’en souviens très nettement, la plus grande félicité. Les deux derniers «entre-stations» me permirent de détailler la dernière personne qui retint mon attention. Une jeune fille, plutôt jolie, dont tout chez elle me rappelait une collègue de ma fiancée : même teint, mêmes yeux sombres, à la fois perçants et opaques,
mystérieux et banals à la fois, les cheveux lisses et la peau inhabituellement lisse, probablement à cause de crèmes diverses appliqués quotidiennement avec soin. Habillée dans des teintes noires et grises, elle renforçait encore cette ressemblance, que seul un visage plus fin et des cils plus allongés venaient rompre timidement. Elle semblait perdue dans cette rame, et son regard balançait de droite à gauche, comme cherchant à se raccrocher
à quelque chose, n’importe quoi pourvu que cela parvenait à la distraire. Rentrant dans un petit jeu qui me paraisait dangereusement attirant, je la fixait jusqu’à ce que je sente son regard se recentrer sur moi -j’étais alors en face d’elle- et je tournait mon attention vers un côté ou l’autre pour lui laisser le loisir de m’observer, peut-être même, espérais-je, de se demander si je l’avais bien regardé. Puis, me recentrant d’un air machinal,
mais en fait terriblement calculé, je cherchais un sujet d’observation plausible qui me permettrait d’avoir son visage dans mon champ de vision. L’ayant trouvé dans la personne d’un gros et vieux monsieur arabe portant une vieille casquette à la française, je jubilait de voir qu’elle détaillait du regard mon t-shirt à motifs blancs. Sans me trahir d’un seul début de sourire en coin, je continuait ce petit jeu jusqu’à ma destination.
Sortant du tramway, je me pris un instant à désirer la voir sortir à ma suite, et engager pour une raison futile la conversation avec moi. Bien sûr, ces arrières pensées n’avaient rien d’un désir amoureux, ni même d’une attirance sexuelle, tout au plus, si cela touchait à la séduction, était-ce parce que j’avais imaginé, en voyant son regard perçant, qu’elle devait être assez intelligente pour mériter qu’on la connût mieux. Mais jettant des coups d’oeil sans espoir, «à tout hasard» dans mon dos, je voyais s’éloigner cette amitié potentielle à 50km/h.
Parcourir la rue pavée, sortir mon trousseau de clés et escalader les escaliers font partie de ces choses qu’on répète tant de fois en une année qu’on en vient à les exécuter sans même en avoir conscience, et peut-être que si, arrivé en haut des escaliers, on se retrouvait à nouveau au début de la rue pavée, on s’engagerait comme une première fois à nouveau sur cette voie sans que cela nous pose un quelconque problème. De telles considérations
me rappellent toujours un enseignement bouddhique que j’avais écouté durant mon adolescence, qui exhortait, afin de méditer sur l’être et la conscience de soi, de rechercher
à penser ces actes insignifiant en parfaite concomittance aver leur réalisation en actes.
L’universalité de ce manque de conscience dans les gestes quotidiens doit faire les choux gras de tous les adeptes de la méditation transcendantale et autres prêcheurs du Soi à tout prix, mais sans doute est-ce une autre question qui nous éloigne de ce que je pensait
réellement à ce moment là.
Après les habituelles salutations, informations données et reçues sur les évènements de la vie de chacun, me vient une idée qui en soi vaut sans doute toutes les méditations du monde. Posant les affaires dont je suis bien aise de me séparer, je file me laver les mains, et, après m’être assuré que personne d’utilisait la terrasse, je file à la cuisine. J’ouvre le placard en bois clair caché derrière la porte, et je fouille du regard son contenu. Un sentiment
de frustration commence à germer à l’intérieur de mon abdomen, mais il est réprimé illico par une vision rassurante. Là, derrière deux paquets de biscottes, était dissimulé le précieux paquet de gâteaux. Je le sors avec empressement, et vide dans ma main les cinq premiers gâteaux qui en sortent. Cela pourrait paraître ridicule à d’autres de nourrir une telle envie pour des biscuits aussi banals en apparence, car ils sont tout sauf luxueux. Ce sont des biscuits ronds aux bords crénelés, fourrés au chocolat, tels qu’on en vend dans tous les supermarchés et stations-services occidentaux depuis les années quatre-vingt dix. Mais pour moi, ces biscuits sont les meilleurs du monde. Cherchant frénétiquement un bol dans le meuble, je m’échauffe en me trompant de tiroir, car le meuble est nouveau et a chamboulé tout le schéma mental que j’avais agencé dans mon esprit depuis dix ans. Puis, mes victuailles à la main, à la vitesse d’un petit chaperon rouge supersonique, je traverse le salon et m’installe à la table en bois de la terasse.
Cette table a quelque chose de reposant. Ce n’est pas une table ronde, et c’est tant mieux, car j’ai les tables rondes en horreur, à partir du moment où elles sont destinées
à autre chose qu’à un concile de chevaliers en armures. Elle est rectangulaire, rectangulaire de manière imposante, mais sans être d’une longueur excessive qui l’aurait rendu prétentieuse. Son bois sombre me faisait éviter le cliché du petit déjeuner nutella, et l’horreur de repenser à moi, dix ans, arborant une coupe au bol parfaite taillée dans des beaux cheveux blonds.
Les chaises en cannelage assorties étaient tout aussi amicales et rassurantes, et, en soi, valaient mieux que des personnes, car ces deux qualités mentionnées finalement, j’aimais autant les retrouver dans une chaise que dans un être humain pour l’instant. Prenant quelques instants le luxe suprême d’embrasser du regard mon bol de lait et mes gâteaux, j’attrappait d’un geste sûr le premier biscuit du bout des doigts, et je l’envoyait tremper dans le lait.
En fait, «envoyer tremper» est une bien vilaine expression, qui ne parvient pas à rendre compte de ce que ce geste avait de merveilleux. En aggripant ce gâteau, j’engagait moi-même ma personne dans une promesse de plaisir gustatif imminent, et lorsque le bisuit
plongeait dans le liquide, je pouvais presque en sentir la froideur, comme si mon corps s’étendait au gâteau par le simple fait de l’appétit. Il se passait alors une chose extrêmement
agréable, d’une insignifiance presque sacrée. Le lait, absorbé par le gâteau ramolli, en augmentait le poids, comme si les deux avaient fusionné. Car pour être honnête, même si j’aime énormément le lait et les gâteaux de manière séparée -n’est-ce pas nécessaire pour se retrouver dans l’état que je décris ?- c’est par dessus tout la conjugaison des deux saveurs qui obtient ma sans réserve et totale adhésion.
Ce moment est pour moi, à chaque fois, une véritable jubilation, et j’imaginais alors que les plus grand alchimistes étaient seuls à pouvoir partager avec moi cette joie qu’ils avaient sans doute goûté en leur temps, à l’heure du goûter lorsque, après avoir râté à nouveau leur transmutation ferrugineuse en or massif, ils se consolaient comme des enfants en se tournant vers cette simple joie de l’alliance parfaite. Quoique je pense par ailleurs que tous les alchimistes doivent probablement pourrir en enfer, car il n’y a pas grand chose de pire qu’un alchimiste sur terre. De toute façon, je me sentais seul, et c’est cela qui était si bon, de savoir que pour moins de trois euros j’atteigait le même degré de conscience que les moines bouddhistes, qui eux devraient en plus, une fois leurs exercices spirituels terminés, se trainer jusqu’au réfectoire du la lamaserie pour grignoter du pain dur et des noyaux d’olive en mobilisant toute leur volonté pour ne pas y prendre plaisir, ce qui ne devait pas être très dur.
D’ailleurs, y a-t-il des réfectoires dans les lamaserie ? J’avais lu quelque part l’histoire
d’un sage bouddhiste qui arrivait à se nourrir de sa propre nourriture spirituelle, et qui ne mangeait jamais, mais allez savoir dans quel livre je l’ai lu ...
C’est à ce moment que je fus tiré de ma rêverie par une voix qui m’appelait. Peu importe, j’avais réussi à manger mes cinq gâteaux.